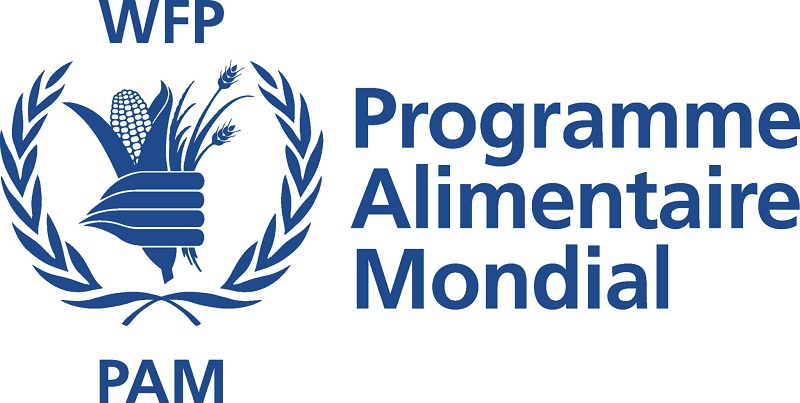L’OIM – Organisation internationale pour les migrations a joué un rôle déterminant en aidant le gouvernement du Niger à respecter ses engagements énoncés dans le Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2014-2018). L’appui fourni a permis à l’État de progresser vers ses objectifs stratégiques en matière de lutte contre la traite des êtres humains (LT) : améliorer le système juridique et institutionnel ; renforcer les mécanismes de prévention de la traite ; promouvoir l’assistance et la prise en charge des victimes de la traite (VTE) ; intensifier les poursuites ; et renforcer la coopération et le partenariat.
Depuis 2019, l’OIM participe activement au « Programme régional de protection et de développement en Afrique du Nord (RDPP-NA) » [YK3] [PG4] financé par l’Union européenne et le ministère italien de l’Intérieur.
Le RDPP NA est une initiative régionale mise en œuvre par plusieurs partenaires, dont COOPI, Save the Children et le HCR, dans d’autres pays tels que la Mauritanie, la Libye, l’Algérie, l’Égypte, le Maroc et la Tunisie.
- But et objectif de l’évaluation
Cette évaluation vise à évaluer dans quelle mesure le projet RDPP a atteint ses objectifs à court, moyen et long terme, ainsi qu’à mettre en évidence les meilleures pratiques, les leçons apprises et les recommandations pour éclairer la programmation future dans les domaines de la gouvernance des migrations et de l’aide à la protection.
L’évaluation portera sur le niveau de réalisation du projet par rapport à son objectif global : « Renforcer les capacités du gouvernement à gérer les migrations de manière intégrée et fondée sur les droits et améliorer la protection des migrants en situation de vulnérabilité. »
Plus précisément, le cabinet de conseil devra :
- Évaluer la pertinence et la validité des stratégies et des activités du projet par rapport à ses objectifs visés.
- Évaluer l’efficacité du projet à contribuer à son objectif et à ses finalités, y compris la qualité globale et les performances de l’intervention ;
- Analyser l’efficacité du projet, en se concentrant sur la manière dont les ressources/intrants (fonds, expertise, temps) ont été convertis en résultats de manière économique ;
- Analyser la durabilité du projet en examinant si les résultats du projet sont susceptibles de perdurer une fois le soutien terminé ;
- Identifier les défis rencontrés lors de la mise en œuvre et évaluer la pertinence et l’adéquation des mesures d’atténuation prises ;
- Identifier les principaux enseignements tirés et les meilleures pratiques selon les critères.
Utilisateurs visés :
L’évaluation informera principalement le public interne de l’OIM, notamment les équipes de l’OIM au Niger et les unités thématiques régionales et mondiales concernées, afin de soutenir l’apprentissage institutionnel et d’éclairer la conception future du projet. Elle servira également les parties prenantes externes – notamment le donateur et les homologues nationaux au Niger – en fournissant une analyse complète de l’efficacité et de l’efficience du projet.
- Critères d’évaluation
L’évaluation appliquera l’ensemble des critères de l’OCDE/CAD – pertinence, cohérence, efficacité, efficience, impact et durabilité – en mettant l’accent sur les critères les plus pertinents pour chaque domaine thématique, notamment la protection et le retour, la réintégration et la gouvernance des migrations.
- Questions d’évaluation
Les questions suivantes doivent être abordées en fonction des critères d’évaluation et du domaine thématique :
- Pertinence (alignement avec les besoins, les priorités et le contexte)
- Dans quelle mesure les objectifs du projet étaient-ils alignés sur les priorités et les engagements du Gouvernement du Niger (GdN), notamment le Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2014-2018) et la Politique nationale de migration ?
- Dans quelle mesure le projet a-t-il répondu aux besoins spécifiques des victimes de la traite (VTE), des enfants non accompagnés et séparés (ESNA) et des Nigériens de retour d’Algérie ?
- Les activités et les résultats du projet ont-ils été conçus de manière appropriée pour répondre aux défis identifiés dans l’analyse du contexte ?
- Cohérence (Coordination et complémentarité avec les autres acteurs)
- Dans quelle mesure le projet a-t-il complété et s’est-il aligné sur les politiques nationales, telles que le Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2022-2026) et la Politique nationale de migration ?
- Dans quelle mesure le projet a-t-il été coordonné avec d’autres acteurs (par exemple, l’ANLTP/TIM, les ONG, les forces de l’ordre et les travailleurs sociaux) pour garantir une réponse harmonisée aux défis de la traite des êtres humains et de la migration ?
- Dans quelle mesure le projet a-t-il coordonné ou contribué à d’autres interventions du RDPP au niveau national et à des partenaires de mise en œuvre (par exemple, le HCR, COOPI, Save the Children) dans le cadre régional du RDPP ?
- Dans quelle mesure les procédures opérationnelles standard (POS), le mécanisme national d’orientation (MNI) et d’autres cadres ont-ils été intégrés efficacement dans les systèmes plus larges de gouvernance des migrations et de protection de l’enfance au Niger ?
- Efficacité (utilisation des ressources et rentabilité)
- Les ressources financières et humaines utilisées de la manière la plus rentable ont-elles donné des résultats ?
- Dans quelle mesure la mise en œuvre du projet a-t-elle respecté le calendrier et le budget prévus ? S’il y a eu des retards ou des dépassements de coûts, quelles en ont été les raisons et comment y ont-ils été corrigés ?
- Efficacité (Réalisation des objectifs et des résultats attendus)
- Impact (changements et résultats à long terme)
- Dans quelle mesure le projet a-t-il atteint les résultats et les effets escomptés, tels que le renforcement du NRM et l’amélioration de l’assistance aux victimes de la traite ?
- Dans quelle mesure les programmes de formation et les efforts de renforcement des capacités ont-ils été efficaces pour améliorer les connaissances et les compétences des principales parties prenantes (forces de l’ordre, travailleurs sociaux, prestataires de services, etc.) ?
- Dans quelle mesure le projet a-t-il amélioré la prestation de services et l’accès aux soins spécialisés pour les victimes de la traite, les enfants en déplacement et les migrants de retour ?
- Quels défis ont été rencontrés lors de la mise en œuvre et comment ont-ils été atténués ?
- Dans quelle mesure le projet a-t-il contribué à renforcer la capacité du gouvernement du Niger à gérer les migrations et à fournir un accueil et une assistance dignes aux Nigériens expulsés ?
- Quelles améliorations tangibles ont été observées dans l’identification, l’orientation et la protection des victimes de la traite et des enfants en déplacement à la suite du projet ?
- Le projet a-t-il influencé les politiques, les cadres ou la législation nationaux liés à la lutte contre la traite et à la gouvernance des migrations ?
- Quelles sont les conséquences positives et négatives indirectes ou imprévues du projet ?
- Durabilité (probabilité de bénéfices continus et d’institutionnalisation)
- Dans quelle mesure les cadres juridiques et institutionnels (GRN, SOP, matériels de formation) établis dans le cadre du projet sont-ils susceptibles d’être maintenus au-delà de la durée du projet ?
- Les institutions nationales et les acteurs locaux sont-ils suffisamment équipés et engagés pour continuer à mettre en œuvre les interventions de manière indépendante ?
- Quelle est la probabilité que les connaissances et les compétences acquises grâce aux activités de renforcement des capacités continuent d’être appliquées et transférées au fil du temps ?
- Quelles mesures pourraient être prises pour garantir l’impact à long terme des interventions du projet ?
Questions transversales : Genre et droits humains
- Dans quelle mesure les questions d’intégration de la dimension de genre ont-elles été prises en compte dans la conception et la mise en œuvre ?
- Dans quelle mesure les différences, les besoins, les rôles et les priorités des femmes, des hommes et des groupes vulnérables spécifiques ont-ils été pris en compte lors de la planification et de la mise en œuvre ?
- Des obstacles à la participation égale des sexes ont-ils été identifiés lors de la conception ou de la mise en œuvre, et des mesures ont-elles été prises pour remédier à ces obstacles ?
- Dans quelle mesure les droits et la dignité des bénéficiaires ont-ils été respectés par le projet et ses partenaires tout au long de la mise en œuvre ?
Dans le cadre de la phase de lancement de l’évaluation, l’équipe d’évaluation sélectionnée peut proposer des questions d’évaluation supplémentaires ou affinées afin de garantir une adéquation totale avec l’objectif, les objectifs et la portée de l’évaluation.
- Méthodologie d’évaluation
L’évaluation utilisera une approche mixte, combinant collecte et analyse de données qualitatives et quantitatives. L’équipe d’évaluation sélectionnée affinera la méthodologie lors de la phase initiale, en étroite collaboration avec l’OIM Niger et les parties prenantes concernées.
Les méthodes de collecte de données comprendront, sans toutefois s’y limiter :
- Une revue documentaire/documentaire qui analysera les documents de référence du projet (proposition, budget, rapports narratifs, cadre logique, rapports de S&E, etc.) et les documents de stratégie et de politique, les évaluations et les leçons tirées des projets précédents.
- La collecte d’informations /données qualitatives s’articulera autour de discussions de groupe (FGD) le cas échéant, d’entretiens individuels et de récits de vie, à l’aide d’outils participatifs appropriés. Des entretiens avec des informateurs clés (KII) seront également menés avec des informateurs clés pertinents tels que (entre autres) le personnel de l’OIM et les partenaires du gouvernement du Niger : les ministères de l’Intérieur, de la Justice, de la Santé, de la Population et des Affaires sociales, des Affaires étrangères, de la Promotion de la femme et de la Protection de l’enfant, de l’Emploi et du Travail ; l’Agence nationale de lutte contre la traite et le trafic illicite (ANLTP-TIM) ; et les autorités régionales de la région de Zinder, en personne et à distance.
- Pour les données quantitatives , l’évaluation s’appuiera sur les données de terrain collectées lors du suivi de routine effectué par les équipes du programme MRRM. Dans la mesure du possible, une courte enquête pourra être menée auprès d’un échantillon représentatif de bénéficiaires du projet, à l’aide d’un questionnaire structuré afin de recueillir des informations quantitatives supplémentaires.
- Pour collecter des données qualitatives et quantitatives, l’équipe d’évaluation peut entreprendre des missions sur le terrain, éventuellement à Zinder et dans d’autres zones de mise en œuvre qui peuvent être pertinentes pour l’évaluation. La sélection du site sera basée sur des considérations de pertinence, d’accès et de sécurité.
L’équipe d’évaluation devra soumettre une méthodologie détaillée dans le cadre du rapport initial d’évaluation qui sera examiné et approuvé par l’équipe de gestion de l’évaluation de l’OIM Niger (y compris le donateur).
L’évaluation doit garantir que les données sur les migrants vulnérables sont collectées et analysées de manière désagrégée (par âge, sexe, nationalité et catégorie de vulnérabilité).
- Éthique, normes et standards d’évaluation
Cette évaluation doit respecter les principes de protection des données de l’OIM, du Groupe d’évaluation des Nations Unies (UNEG [1] ) pour les évaluations et les directives éthiques pertinentes. les normes et standards
En particulier, l’évaluation doit respecter les principes éthiques de consentement éclairé, de confidentialité, de participation volontaire et d’approche « ne pas nuire », en particulier lorsqu’elle s’adresse à des populations vulnérables telles que les victimes de la traite (VTE), les enfants non accompagnés et séparés (ESNA) et les migrants de retour.
Qualifications
- Exigences d’évaluation
Le consultant sélectionné pour cette évaluation peut être un individu, un groupe de consultants ou un cabinet de conseil.
Le chef de l’équipe d’évaluation doit répondre aux exigences minimales suivantes :
- Un diplôme universitaire (niveau maîtrise ou supérieur) en sciences sociales, en études du développement, en relations internationales ou dans un domaine connexe.
- Au moins cinq (5) années d’expérience dans la conception et la conduite d’évaluations de programmes ou de projets et/ou de recherches, de préférence dans des contextes humanitaires.
- Une solide expérience et compréhension des domaines thématiques liés à l’assistance, à la protection et à la réintégration des migrants, ainsi qu’au genre, seront considérées comme un atout.
- Une expérience avérée avec les pays d’Afrique subsaharienne sera un avantage.
- Un historique d’au moins (03) évaluations liées à la migration ou à la protection menées au cours des trois dernières années sera considéré comme un atout majeur.
- Capacité à voyager vers et à l’intérieur du Niger, y compris sur le terrain.
- La maîtrise de l’anglais est requise, avec une bonne maîtrise du français.
Les critères suivants contribueront à la présélection du consultant :
| N | Critères | Score |
| 1 | Au moins 5 années d’études supérieures dans le domaine des sciences sociales, des statistiques, du développement, | 5 |
| 2 | Bonne connaissance des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives et de l’analyse des données | 20 |
| 3 | Expérience dans la conduite d’activités d’évaluation auprès de personnes vulnérables, de préférence des migrants | 40 |
| 4 | Bonne connaissance des thématiques de protection et de genre et de leur inclusion dans la proposition d’évaluation | 10 |
| Total | 75 |
- Budget
Le budget alloué à cette consultation est de 30 000 à 35 000 euros tout compris . [YK1] [PG2]
- Dépôt de la candidature
COMMENT POSTULER – Les candidats intéressés sont invités à soumettre les éléments suivants :
- Proposition technique : le candidat devra soumettre une proposition technique solide et détaillée, incluant un calendrier détaillé de l’évaluation. Un curriculum vitae détaillant les connaissances et l’expérience dans les domaines susmentionnés devra être inclus, ainsi qu’au moins deux références attestant que le consultant est familiarisé avec ce type d’évaluation dans des contextes similaires à celui du Niger au cours des trois dernières années.
- Proposition financière / budget détaillé – tout compris – incluant les tarifs journaliers, les dépenses, les taxes, etc.
Une équipe de l’OIM Niger notera les documentations fournies par le consultant potentiel en fonction de son « savoir-faire » technique et des honoraires attendus sur la base de 75 % pour la proposition technique et de 25 % pour la proposition financière.